
Connaître, utiliser et restaurer les lampes à carbure
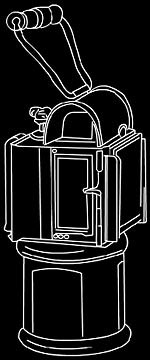
![]() acethylene.com
acethylene.com
![]()
LAMPES et LANTERNES DES CHEMINS DE FER
Lampes acétylène - Lampes à carbure - Lampes SNCF - Lanternes des compagnies de trains
![]()
Textes & Réalisation : Dominique Paris
Remerciements à Daniel Juge
www.acethylene.com - www.explographies.com -
www.geopedia.fr
Textes, photographies et documents déposés.
© 2001-2007 explographies.com - Tous droits réservés - Publication, reproduction totale ou partielle interdite.
explographies. - cube - acethylene - planches igc - carrières & catacombes - photos - atlas 1855- cartographies - géologie - topos & histoire - salle k - geopedia
![]()

Les lampes des compagnies ferroviaires
Les chemins de fer ont longtemps été parmi les plus gros utilisateurs d’éclairages à acétylène.
Lorsque le procédé se répand au début du XXème siècle, essentiellement dans le domaine des lanternes portatives, prenant la place des lanternes à huile ou à pétrole, le réseau français est encore partagé en grandes compagnies privées :
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est
- La Compagnie des chemins de fer du Nord
- La Compagnie de l’Ouest qui sera rachetée par la puissance publique pour devenir le Réseau de l’Etat
- La Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans (le PO)
- La Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (le PLM)
- Le Réseau d’Alsace-Lorraine (l’AL) créé après la modification de frontière de 1919.
![]() Chaque compagnie développe ses propres modèles de lanternes et traite avec ses fournisseurs privilégiés (exemple, le PO qui travaille beaucoup avec la société
Maisoneuve). Ainsi, les lanternes à acétylène ont des morphologies très différentes selon les compagnies, chacune ayant ses préférences techniques ou esthétiques, sans trop se soucier de rationalité ou de réduction des coûts. Ainsi, certains modèles sont d’une complexité étonnante et
leur fabrication demandes de nombreuses heures de travail.
Chaque compagnie développe ses propres modèles de lanternes et traite avec ses fournisseurs privilégiés (exemple, le PO qui travaille beaucoup avec la société
Maisoneuve). Ainsi, les lanternes à acétylène ont des morphologies très différentes selon les compagnies, chacune ayant ses préférences techniques ou esthétiques, sans trop se soucier de rationalité ou de réduction des coûts. Ainsi, certains modèles sont d’une complexité étonnante et
leur fabrication demandes de nombreuses heures de travail.
![]() Si les lanternes portatives à acétylène équipent les cheminots, par contre, le côté capricieux du système le rend inapte à certaines utilisations : fanaux des
locomotives qui restent au pétrole, tout comme les lanternes de signaux (à l’exception de certaines éclairées à l’acétylène, mais dans ce cas elles sont raccordées à des bonbonnes de gaz pur et non à des générateurs à carbure). Certains modèles de lanternes à main, comme les lanternes
d’allumeurs de signaux, ou celles des gardiens de passages à niveau, restent aussi à pétrole.
Si les lanternes portatives à acétylène équipent les cheminots, par contre, le côté capricieux du système le rend inapte à certaines utilisations : fanaux des
locomotives qui restent au pétrole, tout comme les lanternes de signaux (à l’exception de certaines éclairées à l’acétylène, mais dans ce cas elles sont raccordées à des bonbonnes de gaz pur et non à des générateurs à carbure). Certains modèles de lanternes à main, comme les lanternes
d’allumeurs de signaux, ou celles des gardiens de passages à niveau, restent aussi à pétrole.
![]() Toutes ces lanternes en laiton, ou plus rarement en maillechort ou encore en fer blanc, sont plus ou moins maltraitées dans le « feu de l’action » et demandent
beaucoup de maintenance. C’est le travail des agents des « lampisteries » qui passent leur temps à ressouder à l’étain des pièces ou en remplacer d’autres trop abîmées, ou encore changer les verres brisés. Ces lampisteries, on en trouve dans la plupart des gares et dépôts de
locomotives. Chaque établissement possède également son dépôt de carbure de calcium, un petit bâtiment isolé où foisonnent les panneaux « interdiction de pénétrer avec un feu nu ou une cigarette ».
Toutes ces lanternes en laiton, ou plus rarement en maillechort ou encore en fer blanc, sont plus ou moins maltraitées dans le « feu de l’action » et demandent
beaucoup de maintenance. C’est le travail des agents des « lampisteries » qui passent leur temps à ressouder à l’étain des pièces ou en remplacer d’autres trop abîmées, ou encore changer les verres brisés. Ces lampisteries, on en trouve dans la plupart des gares et dépôts de
locomotives. Chaque établissement possède également son dépôt de carbure de calcium, un petit bâtiment isolé où foisonnent les panneaux « interdiction de pénétrer avec un feu nu ou une cigarette ».

Les modèles de lampes des chemins de Fer
![]() Au 1er janvier 1938, suite à la nationalisation des chemins de fer, les compagnies privées cèdent la place à la Société nationale des chemins de fer français. La
SNCF unifie dès l’immédiat après-guerre les lanternes à acétylène. Les nouveaux modèles unifiés, commandés pour la plupart à Butin-Gillet, remplacent petit à petit, au fur et à mesure de leur usure, les modèles issus des anciennes compagnies, mais ceux-ci perdureront suffisamment
longtemps chez quelque cheminots plus soigneux que les autres pour finir par se retrouver aujourd’hui en nombre chez les collectionneurs !
Au 1er janvier 1938, suite à la nationalisation des chemins de fer, les compagnies privées cèdent la place à la Société nationale des chemins de fer français. La
SNCF unifie dès l’immédiat après-guerre les lanternes à acétylène. Les nouveaux modèles unifiés, commandés pour la plupart à Butin-Gillet, remplacent petit à petit, au fur et à mesure de leur usure, les modèles issus des anciennes compagnies, mais ceux-ci perdureront suffisamment
longtemps chez quelque cheminots plus soigneux que les autres pour finir par se retrouver aujourd’hui en nombre chez les collectionneurs !
Les modèles unifiés SNCF comportent :
- Les lanternes de chefs de train
- Les lanternes d’agents de gare
- Les lanternes de pointeur (le pointeur est l’agent qui relève les indications sur les wagons de marchandises) qui consistent en une lampe calée dans une cage portative.
- Les lanternes de mécanicien de locomotive, avec chargement de carbure par une ouverture latérale fermée par un gros bouchon à vis.
- Les générateurs à feu nu à étrier, de tailles différentes, utilisés essentiellement par les agents de la voie (éclairage de chantiers nocturnes, ou en tunnel).
![]() Toutes les lanternes, sauf celles de pointeurs, comportent un volet vitré pivotant, rabattable sur la face avant, équipé d’un verre teinté rouge.
Toutes les lanternes, sauf celles de pointeurs, comportent un volet vitré pivotant, rabattable sur la face avant, équipé d’un verre teinté rouge.
![]() Les lanternes SNCF se caractérisent par une réserve à becs, située dans la poignée sur les lanternes de chefs de train et agents de gare, et dans un tube soudé
extérieur sur les autres modèles (tube fermé par un bouchon à vis, fendu sur sa tête pour être dévissé à l’aide d’une pièce de monnaie). Les chapiteaux sont protégés sur leur face interne par une couche d’isolant amianté. On note sur les lanternes et générateurs la présence
quasi-systématique d’un crantage sur le pointeau, assurant un réglage fin et stable du « goutte à goutte », et d’un large bouchon fileté ; ainsi Butin commercialise des lanternes et générateurs à la fois pour la SNCF et le grand public, mais seuls les modèles SNCF possèdent le
crantage. C’est le cas de la lanterne n° 250 ; le modèle SNCF possède le crantage sur le pointeau, un réservoir à bec sous la cage et un réservoir à carbure plus large que le modèle grand public. Citons également le générateur à feu nu, qualifié de « lampe de mine à étrier série 142 »,
largement utilisé par les agents de la voie. Là aussi, le modèle SNCF possède un pointeau cranté et un large bouchon de laiton vissé, alors que le modèle du commerce est livré avec pointeau non cranté et bouchon de taille réduite.
Les lanternes SNCF se caractérisent par une réserve à becs, située dans la poignée sur les lanternes de chefs de train et agents de gare, et dans un tube soudé
extérieur sur les autres modèles (tube fermé par un bouchon à vis, fendu sur sa tête pour être dévissé à l’aide d’une pièce de monnaie). Les chapiteaux sont protégés sur leur face interne par une couche d’isolant amianté. On note sur les lanternes et générateurs la présence
quasi-systématique d’un crantage sur le pointeau, assurant un réglage fin et stable du « goutte à goutte », et d’un large bouchon fileté ; ainsi Butin commercialise des lanternes et générateurs à la fois pour la SNCF et le grand public, mais seuls les modèles SNCF possèdent le
crantage. C’est le cas de la lanterne n° 250 ; le modèle SNCF possède le crantage sur le pointeau, un réservoir à bec sous la cage et un réservoir à carbure plus large que le modèle grand public. Citons également le générateur à feu nu, qualifié de « lampe de mine à étrier série 142 »,
largement utilisé par les agents de la voie. Là aussi, le modèle SNCF possède un pointeau cranté et un large bouchon de laiton vissé, alors que le modèle du commerce est livré avec pointeau non cranté et bouchon de taille réduite.



Lanterne des chemins de fer en Bakélite (Allemagne) 1945 - Collection privée.

Les couleurs des feux
![]() A la création de la SNCF, les lanternes d’agents de gare, d’agents de manœuvres ou de chefs de train, comportent un verre blanc à l’avant, un verre rouge latéral
et un verre vert sur le côté opposé. Lors de manœuvres nocturnes, on utilise le vert, en balançant la lanterne, pour signifier « tirer ».
A la création de la SNCF, les lanternes d’agents de gare, d’agents de manœuvres ou de chefs de train, comportent un verre blanc à l’avant, un verre rouge latéral
et un verre vert sur le côté opposé. Lors de manœuvres nocturnes, on utilise le vert, en balançant la lanterne, pour signifier « tirer ».
![]() Suite à des accidents dus à la confusion entre le signal « tirer » lors de manœuvres et le signal du départ en ligne, la SNCF décide de réserver le feu vert au
seul départ en ligne. A compter du 1er mars 1948, tous les écrans teintés verts sont supprimés sur toutes les lanternes et remplacés par un verre blanc, à l’exception des lanternes des agents de gare autorisés à donner le départ des trains. Pour ces seules lanternes
conservant le vert, afin d’éviter un départ de train non intentionnel, le feu vert est occulté par un volet mobile, commandé via un câble sous gaine métallique (un peu comme les commandes de frein de vélo…), depuis la poignée de la lanterne par un bouton-poussoir ; ainsi, le
découvrement du vert ne peut être qu’un acte volontaire.
Suite à des accidents dus à la confusion entre le signal « tirer » lors de manœuvres et le signal du départ en ligne, la SNCF décide de réserver le feu vert au
seul départ en ligne. A compter du 1er mars 1948, tous les écrans teintés verts sont supprimés sur toutes les lanternes et remplacés par un verre blanc, à l’exception des lanternes des agents de gare autorisés à donner le départ des trains. Pour ces seules lanternes
conservant le vert, afin d’éviter un départ de train non intentionnel, le feu vert est occulté par un volet mobile, commandé via un câble sous gaine métallique (un peu comme les commandes de frein de vélo…), depuis la poignée de la lanterne par un bouton-poussoir ; ainsi, le
découvrement du vert ne peut être qu’un acte volontaire.
![]() Dans les nouvelles règles à compter du 1er mars 1948, le signal « tirer » est dorénavant donné par un mouvement vertical répété du feu blanc de la
lanterne. Le balancement à bout de bras du même feu blanc signifie « refouler ».
Dans les nouvelles règles à compter du 1er mars 1948, le signal « tirer » est dorénavant donné par un mouvement vertical répété du feu blanc de la
lanterne. Le balancement à bout de bras du même feu blanc signifie « refouler ».
![]() A noter que pendant la guerre de 1939-1945, les lanternes sont livrées à la SNCF avec un maximum de pièces en laiton, remplacées par les mêmes mais en fer blanc,
rareté du cuivre oblige… A cette époque, on prend aussi l’habitude de peindre en noir semi mat les lanternes. Ainsi, les parties en fer blanc sont protégées de la corrosion, mais, en plus, la corvée d’astiquage du laiton disparaît… Quelques décennies plus tard, les collectionneurs
maudiront cette pratique les obligeant à de fastidieuses opérations de décapage de cette peinture noire très difficile à retirer…
A noter que pendant la guerre de 1939-1945, les lanternes sont livrées à la SNCF avec un maximum de pièces en laiton, remplacées par les mêmes mais en fer blanc,
rareté du cuivre oblige… A cette époque, on prend aussi l’habitude de peindre en noir semi mat les lanternes. Ainsi, les parties en fer blanc sont protégées de la corrosion, mais, en plus, la corvée d’astiquage du laiton disparaît… Quelques décennies plus tard, les collectionneurs
maudiront cette pratique les obligeant à de fastidieuses opérations de décapage de cette peinture noire très difficile à retirer…



Lanterne sncf Laiton et fer 1930-1940 - Collection privée.

Le remplacement des lampes ferroviaires
![]() Dans les années 1950, les lanternes électriques se généralisent. Leur facilité d’utilisation, par rapport aux servitudes des lanternes à acétylène (réglages,
déchaulage, maintenance, manque de souplesse…), attise l’impatience des cheminots, et l’on cite beaucoup de cas de dégradations volontaires, suivies d’un « chef, ma lanterne acéto est morte, j’peux avoir une électrique ? ». D’autres, par contre, attachés à leur bonne vieille lanterne,
qu’ils bichonnent amoureusement, la garderont jusqu’au dernier moment.
Dans les années 1950, les lanternes électriques se généralisent. Leur facilité d’utilisation, par rapport aux servitudes des lanternes à acétylène (réglages,
déchaulage, maintenance, manque de souplesse…), attise l’impatience des cheminots, et l’on cite beaucoup de cas de dégradations volontaires, suivies d’un « chef, ma lanterne acéto est morte, j’peux avoir une électrique ? ». D’autres, par contre, attachés à leur bonne vieille lanterne,
qu’ils bichonnent amoureusement, la garderont jusqu’au dernier moment.
![]() Les derniers cas d’utilisation en service de lanternes à acétylène se situent à la fin des années 1960, notamment chez les agents travaillant encore sur les
machines à vapeur [j’ai personnellement assisté à l’utilisation de lanterne de mécanicien, au dépôt vapeur de Guingamp, en 1969]. Les agents de l’Equipement, par contre, utiliseront leur générateurs à feu nu assez longtemps, parfois jusqu’aux années 1980. L’arrêt de la fabrication des
becs de rechange aura raison des dernières poches de résistance…
Les derniers cas d’utilisation en service de lanternes à acétylène se situent à la fin des années 1960, notamment chez les agents travaillant encore sur les
machines à vapeur [j’ai personnellement assisté à l’utilisation de lanterne de mécanicien, au dépôt vapeur de Guingamp, en 1969]. Les agents de l’Equipement, par contre, utiliseront leur générateurs à feu nu assez longtemps, parfois jusqu’aux années 1980. L’arrêt de la fabrication des
becs de rechange aura raison des dernières poches de résistance…
![]() Les ateliers Butin Gillet, alors situés à Montreuil, ferment vers 1980, après avoir livré une dernière série de lampes à pétrole de gardien de passage à niveau
pour La Vie du Rail qui les propose à la vente. Des milliers de pièces détachées de lanternes (dont des milliers de becs Lecoq) partent chez un récupérateur de métaux, malgré les vaines tentatives de collectionneurs pour récupérer des pièces.
Les ateliers Butin Gillet, alors situés à Montreuil, ferment vers 1980, après avoir livré une dernière série de lampes à pétrole de gardien de passage à niveau
pour La Vie du Rail qui les propose à la vente. Des milliers de pièces détachées de lanternes (dont des milliers de becs Lecoq) partent chez un récupérateur de métaux, malgré les vaines tentatives de collectionneurs pour récupérer des pièces.
CREDITS
Remerciements à Daniel Juge
Photos Kalimero - Dessins nexus
www.acethylene.com -
www.explographies.com - www.geopedia.fr
Textes, photographies et documents déposés.
© 2001-2007 explographies.com - Tous droits réservés - Publication, reproduction totale ou partielle interdite.
explographies. - cube - acethylene - planches igc - carrières & catacombes - photos - atlas 1855- cartographies - géologie - topos & histoire - salle k - geopedia